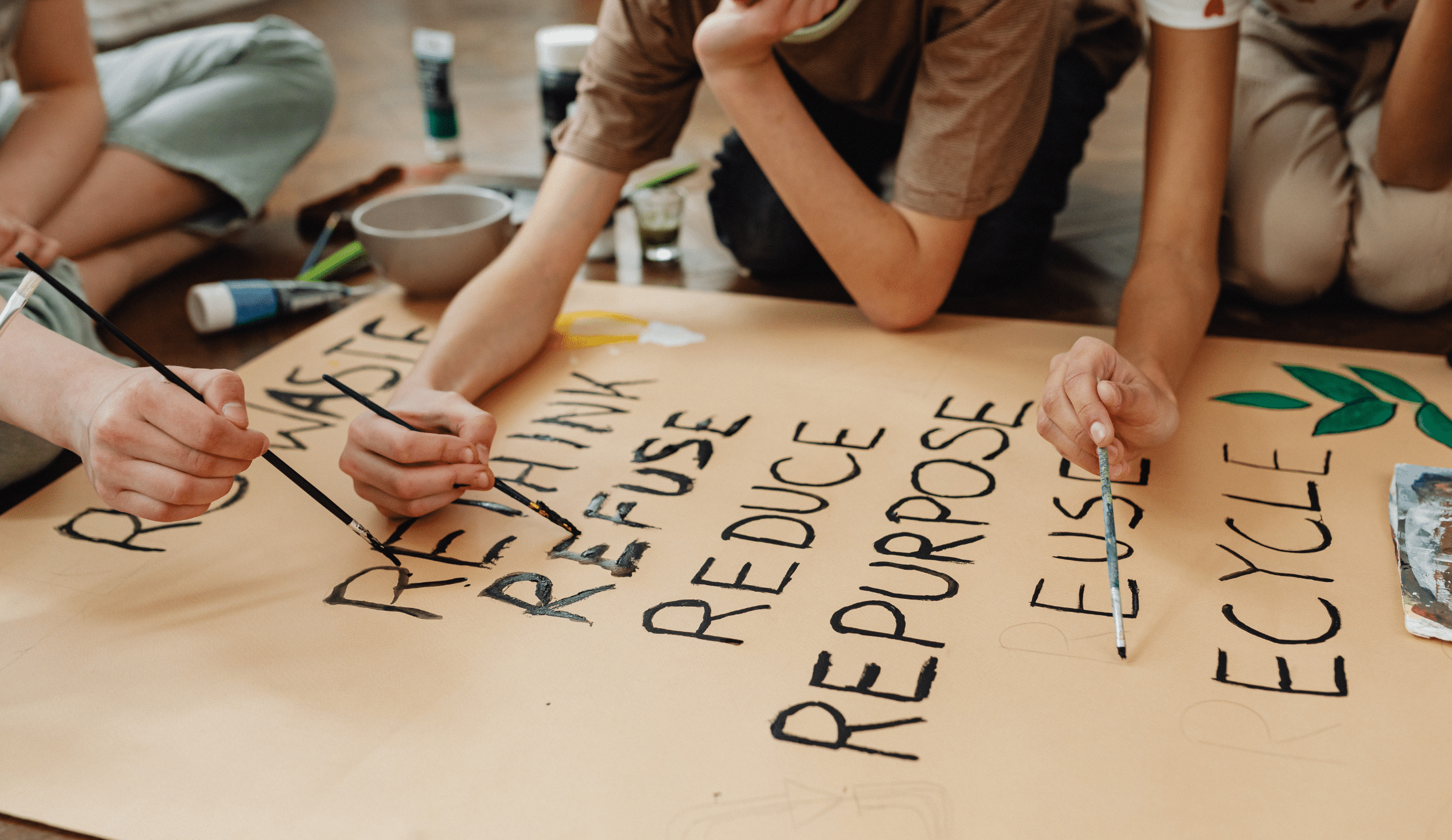Face à l’urgence écologique, comment concilier réussite professionnelle, équilibre de vie et impact positif sur la planète ? Thomas Burbidge, entrepreneur et auteur engagé, partage son parcours, ses outils et ses conseils pour transformer son entreprise en levier d’action écologique. Du triangle de l’inaction au mandala du pouvoir écologique, en passant par le ROI environnemental et le rôle stratégique du consommateur, il livre une vision concrète et inspirante de l’entrepreneuriat durable.
En tant qu’entrepreneur, quel a été le déclic qui vous poussé à articuler réussite professionnelle, équilibre de vie et écologie ?

Thomas Burbidge : Je ne crois pas qu’il y ait eu un seul « déclic ». Pour moi, ça a été un cheminement graduel. J’ai toujours eu ces préoccupations quelque part en arrière-plan, héritées de mes parents je pense et de mon éducation, mais elles ont pris de plus en plus de place au fil des années.
D’abord parce que l’écologie est devenue impossible à ignorer dans l’espace public : canicules, incendies, franchissement des limites planétaires, multiplication des conversations. Ensuite parce que, dans mon quotidien de coach et d’entrepreneur, ce sont aussi les gens autour de moi qui m’ont renvoyé ces questionnements, parfois de manière très bouleversante, comme cette cliente dont la fille de 7 ans lui a dit « je préfère mourir » en découvrant les nouvelles écologiques aux infos. Mes lectures aussi, parce que j’ai cherché à comprendre : « comment ça se fait qu’on sache que la crise arrive, mais on ne bouge pas assez vite et fort pour la résoudre ? ».
Tout ça s’est accumulé en moi : la peur, le doute, mais aussi une certitude de plus en plus forte. Je ne pouvais plus me contenter de cloisonner ma vie professionnelle d’un côté et mes valeurs de l’autre. Je ne pouvais plus me dire que ce sujet serait pris en charge « par d’autres ». Alors, oui, c’est une progression plus qu’un choc, mais une progression qui m’a conduit à une conclusion radicale : nous devons tous et toutes intégrer l’écologie dans toutes les dimensions de nos vies, en particulier dans nos entreprises. Mon livre est la résultante de ce chemin-là, et la seule manière cohérente que j’ai trouvée pour continuer à entreprendre, en m’engageant pleinement dans la façon dont mon activité entrepreneuriale pourrait contribuer aux solutions à la crise écologique.
Vous parlez dans votre ouvrage du triangle de l’inaction. Pouvez-vous expliquer ce concept et en quoi il nous empêche d’agir face aux crises actuelles ?

Thomas Burbidge : Le triangle de l’inaction illustre pourquoi, malgré la gravité des crises, rien ne bouge vraiment. Il comporte trois pôles : individus-consommateurs, entreprises et politiques. Chacun se renvoie la responsabilité comme une patate chaude.
Les individus pensent : « Ce n’est pas moi avec mes choix quotidiens qui vais changer la donne, c’est aux politiques d’imposer des lois fortes ». Les politiques répondent : « On ne peut pas tout faire, ce sont les entreprises qui détiennent les ressources et doivent transformer leurs modèles ». Les entreprises, elles, renvoient la balle aux consommateurs : « Nous répondons à la demande ; si les gens changent leurs habitudes, on s’adaptera ». Le cycle recommence… pendant que l’urgence s’aggrave.
Ce schéma est dangereux : il entretient une paralysie collective. Chacun se persuade que le pouvoir d’agir appartient à un autre maillon. Résultat : tout le monde attend, et rien n’avance à la vitesse ni à l’échelle nécessaires.
Là où c’est intéressant, c’est que les entrepreneurs indépendants occupent une position unique pour casser ce cercle vicieux. Nous sommes à la fois :
- Individus, capables d’agir dans nos choix de consommation et notre rapport à la nature ;
- Acteurs économiques, avec une agilité incomparable pour réinventer nos modèles, expérimenter et inspirer nos clients ;
- Citoyens, avec des compétences pour influencer les débats politiques et médiatiques, pitcher et créer du contenu pour l’écologie.
Cette triple posture donne aux indépendants un pouvoir écologique considérable. C’est de ce constat qu’est née la thèse du livre et le plan d’action proposé : montrer que nous ne sommes pas condamnés à subir le triangle de l’inaction, mais que nous avons tout en main pour agir et faire une vraie différence.
À l’inverse, vous proposez le mandala du pouvoir écologique. Comment se structure-t-il ?
Thomas Burbidge : Le mandala du pouvoir écologique est ma réponse au triangle de l’inaction. Là où le triangle montre une paralysie, chacun se renvoie la responsabilité et personne n’agit, le mandala souligne que nous avons du pouvoir sur chacun des pôles.
- Reprendre son pouvoir de consommateur : chacun peut influencer la demande par ses choix. Nos comportements orientent le marché et envoient des signaux forts aux entreprises, permettant d’adopter des modes de vie plus écologiques.
- Reprendre son pouvoir entrepreneurial : en tant qu’indépendants, nous pouvons transformer nos modèles, expérimenter rapidement et montrer la voie. Redéfinir nos offres, notre communication et notre vision de la réussite permet de contribuer à la régénération du vivant et d’inspirer d’autres acteurs.
- Reprendre son pouvoir politique et citoyen : voter, interpeller les représentants, prendre la parole dans les médias, rejoindre des mouvements ou s’engager en politique contribue à changer les règles du jeu. Les compétences entrepreneuriales sont précieuses pour que l’écologie devienne centrale dans l’organisation collective.
À ces trois dimensions s’ajoute l’écologie personnelle. S’engager durablement exige de préserver son énergie et d’éviter le burn-out militant, afin que l’action puisse s’inscrire dans la durée.
Le mandala du pouvoir écologique est donc une carte qui permet à chacun d’identifier où il a le plus d’impact et quel rôle jouer selon sa position. L’objectif n’est pas que tout le monde agisse partout, mais que chacun trouve sa place spécifique et construise un plan d’action concret pour intégrer l’écologie dans toutes les dimensions de sa vie.
Quels sont les fondamentaux d’un ROI écologique positif ?
Thomas Burbidge : La notion de ROI écologique, c’est une manière de retourner une logique classique de l’entreprise : return on investment. Normalement, quand on parle de retour sur investissement, on ne regarde qu’un seul indicateur : la rentabilité financière. Moi, je propose d’élargir cette grille de lecture pour intégrer l’impact écologique réel de nos actions.
Un ROI écologique positif, c’est d’abord reconnaître que chaque entreprise consomme trois types de capitaux : financier, humain et naturel. Or aujourd’hui, tout le système est orienté vers la maximisation du capital financier, en négligeant les deux autres. La première étape, c’est donc de remettre ces trois capitaux sur un pied d’égalité.
Ensuite, ça veut dire qu’on doit chercher à générer des externalités positives plutôt que d’aggraver les externalités négatives. Concrètement : Est-ce que l’activité de mon entreprise régénère et restaure l’habitat dont nous et notre espèce humaine dépends ? Ou est-ce qu’elle contribue à dégrader encore plus nos ressources ?
Le ROI écologique se mesure donc à l’aune de trois fondamentaux :
- Réduire : limiter la consommation de ressources non renouvelables, optimiser nos usages, éviter le superflu.
- Remplacer : substituer des ressources ou des pratiques polluantes et nous renouvelables par des alternatives soutenables qu’on peut régénérer.
- Restaurer : investir activement dans la régénération de toutes les ressources dont nos sociétés dépendent : la biodiversité, la qualité des sols, le cycle de l’eau, les forêts…
Un ROI écologique positif, c’est quand une entreprise contribue à recréer plus de ressources naturelles qu’elle n’en détruit – et donc à préserver la capacité de vie sur terre. Et c’est ça, pour moi, le nouveau standard que l’on devrait viser : ne plus se contenter d’« être moins pire », mais se demander comment, à chaque décision, on peut participer à régénérer ce qui nous permet de survivre, et nous épanouir.
Vous évoquez le fait de cibler sa clientèle / son coeur du cible. Mais pour changer le système, il faut créer un changement collectif ?
Thomas Burbidge : L’écologie est par définition un sujet collectif : l’enjeu est de transformer la société à tous les niveaux. C’est pourquoi la question de la cible de clientèle est cruciale pour un entrepreneur engagé.
Beaucoup pensent qu’il faut travailler uniquement avec des clients déjà convaincus par l’écologie. En réalité, il est nécessaire d’agir partout et à tous les niveaux.
Deux approches sont complémentaires :
-
Travailler avec des structures déjà engagées : boîtes à impact, pionniers… pour les aider à aller plus loin, prendre des parts de marché et montrer que des modèles écologiques peuvent devenir dominants.
-
Accompagner des acteurs plus en retard ou réfractaires, pour qu’ils progressent. Les abandonner reviendrait à laisser le champ libre aux logiques les plus destructrices.
La vraie question devient : selon mes compétences, mon marché et mon offre, qui est la cible la plus pertinente pour maximiser l’impact écologique et accélérer le changement collectif ?
Ce ciblage impacte toute la stratégie de l’entreprise. Avec une clientèle déjà convaincue, on peut afficher son engagement de manière explicite et directe. Avec des clients réticents, il s’agit d’intégrer l’écologie dans sa méthode de travail, sans en faire un argument de communication frontal. Dans les deux cas, l’entreprise contribue à faire progresser le système.
Cibler, ce n’est donc pas se couper du changement collectif : c’est choisir l’endroit où son action aura l’effet domino le plus fort, pour créer un impact maximal tout en restant cohérent avec ses valeurs et ses compétences.
Dans son offre et sa communication faut-il afficher son engagement écologique et de quelle manière ?
Thomas Burbidge : Il n’y a pas de règle unique pour afficher son engagement écologique, mais une cohérence à trouver selon sa cible et son positionnement.
Si ta clientèle est déjà sensible aux enjeux écologiques, il est pertinent de montrer clairement ton engagement. Dans ce cas, ton positionnement devient un critère de choix pour le client : “je suis aligné avec tes valeurs et je vais t’aider à aller plus loin”. Ton discours peut être direct, assumé et revendiqué.
À l’inverse, si ta clientèle n’est pas sensible ou est réticente, il vaut mieux ne pas faire de l’écologie ton argument principal. Il s’agit alors d’intégrer profondément la pensée écologique dans ta méthode de travail et de montrer, par les résultats et l’expérience, que d’autres manières de faire sont possibles.
L’écologie doit avant tout être incorporée dans toutes les facettes de l’entreprise, avant d’être un argument de communication ou une “couche de peinture verte”. Selon ton audience, tu choisis de l’afficher frontalement ou de l’incarner silencieusement. Dans tous les cas, l’important est que ce soit réel, tangible et cohérent.
Concrètement, l’engagement peut se manifester dans :
-
La structure de l’offre : choix des matériaux, partenaires, ou mécanismes de redistribution comme reverser un pourcentage du chiffre d’affaires à des actions écologiques.
-
La relation commerciale : expliquer dès les rendez-vous comment ta méthodologie s’inscrit dans une démarche écologique.
-
Les supports de communication : privilégier transparence, preuve et pédagogie plutôt que slogans ou messages marketing.
En résumé : affiche ton engagement écologique quand il crée du lien et de la confiance, et incarne-le dans ta pratique quand ce n’est pas encore un critère de décision pour ta cible. Dans tous les cas, fais-le de manière concrète, vérifiable et intégrée à ton activité, plutôt que comme un simple vernis marketing.
Quelles éco-compétences entrepreneuriales faut-il pour imaginer un autre type d’entreprise ?
Thomas Burbidge : La première éco-compétence fondamentale consiste à mesurer et comprendre l’impact écologique de son entreprise. Nous sommes tellement déconnectés de la fabrication des outils que nous oublions leur coût réel en ressources naturelles.
Prenons l’exemple de l’ordinateur, outil central pour la majorité des entrepreneurs : derrière lui se cachent du cuivre, du lithium, du pétrole transformé en plastique. Autant de ressources limitées, non renouvelables, que nous consommons sans mesurer les conséquences.
Tant que cet impact n’est pas évalué, nous avançons à l’aveugle. La plupart des entrepreneurs sont incapables de comparer le coût écologique de trois heures de travail sur ordinateur avec celui d’une heure d’utilisation d’une intelligence artificielle. Développer cette compétence de mesure est donc la première marche : apprendre à évaluer nos outils et nos méthodes non seulement en termes de performance, mais aussi de coût écologique.
De cette prise de conscience naissent d’autres éco-compétences. Par exemple, comprendre que certaines méthodes de communication ont un impact environnemental élevé pousse à inventer des alternatives plus sobres et moins énergivores.
Vient ensuite la prise de recul systémique : sortir du vase clos de son activité pour analyser les externalités négatives sur les écosystèmes et comprendre comment son entreprise s’inscrit dans un ensemble plus large. C’est ce regard élargi qui permet de repenser ses choix stratégiques.
Enfin, dans un monde de plus en plus instable, une compétence clé est la capacité à construire des entreprises robustes. Plus la crise écologique s’aggrave, plus nos sociétés deviennent fragiles. Demain, ce ne sera ni la productivité ni l’optimisation qui feront la différence, mais la résilience : être capable d’absorber les chocs, de durer et de continuer à exister malgré l’incertitude.
Quel est le rôle du consommateur dans ce changement de paradigme ?
Thomas Burbidge : On a tendance à surestimer le rôle du consommateur, notamment dans le discours politique, avec cette idée que « si chacun fait ses écogestes », on trouvera la solution. Ce n’est pas vrai. Bien sûr, nos modes de consommation ont un impact. Si demain, 100% des Français boycottaient les fruits et légumes cultivés aux pesticides, l’offre du marché basculerait immédiatement. Mais il faut être lucide : beaucoup de consommateurs n’ont pas la liberté de leurs choix, parce que les alternatives écologiques restent plus chères, ou moins accessibles. La responsabilité ne peut donc pas peser uniquement sur leurs épaules.
Alors oui, il est nécessaire d’orienter nos habitudes pour réduire leur coût écologique – par exemple en arrêtant l’avion dès que c’est possible – mais le rôle du consommateur ne s’arrête pas là. Il doit aussi devenir un citoyen actif, qui utilise sa voix et sa voie pour peser sur les règles du jeu. Car au fond, ce qui changera réellement les choses, ce n’est pas seulement la somme des choix individuels : c’est la transformation du cadre politique et économique qui structure nos choix.
Et pour les entrepreneurs, cette question prend une dimension encore plus forte : nous ne sommes pas seulement consommateurs à titre individuel, mais aussi consommateurs à titre professionnel. Chaque entreprise choisit ses partenaires, ses prestataires, ses fournisseurs. Et ces choix orientent directement l’économie : travailler avec un imprimeur qui fait du papier recyclé, avec un hébergeur web qui utilise des énergies renouvelables, ou avec des prestataires qui partagent tes valeurs, ce sont autant de décisions qui accélèrent le changement bien plus vite que d’acheter ses tomates bio.
Le vrai pouvoir du consommateur, c’est donc d’assumer cette double posture : orienter la demande par ses achats, personnels et professionnels, tout en s’engageant collectivement pour changer les règles du jeu.
Si vous deviez donner un seul conseil aux entrepreneurs qui veulent s’engager sur ce modèle d’entrepreneuriat durable, quel serait-il ?
Thomas Burbidge : Commencez par mesurer !
La porte d’entrée la plus simple pour faire ça, c’est de réaliser votre bilan carbone “grand public” (le simulateur gouvernemental fait très bien le job) ou un autre outil fiable et gratuit. Si vous êtes indépendant·e, votre vie perso et votre activité étant intimement liées, ce bilan vous donnera déjà une photo cohérente de vos impacts.
Côté entreprise, il n’existe pas encore d’outil gratuit vraiment complet pour un bilan carbone pro. Si vous avez les moyens, faites-vous accompagner : il existe des cabinets et plateformes sérieuses pour mesurer l’empreinte de votre activité. Mais l’essentiel, pour démarrer, c’est de mettre des chiffres sur “ce que coûte écologiquement” votre boîte.
Une fois la mesure posée, les pistes d’action prioritaires apparaissent d’elles-mêmes : vous verrez vos 2-3 “gros postes” et vous pourrez décider quoi réduire, quoi remplacer, et où restaurer (en proportion de votre impact).
Une autre action “simple”, c’est de décider de rediriger une partie de son capital financier vers des acteurs de l’écologie, disons 1% de votre chiffre d’affaires mensuel ou annuel, que vous reversez à une association.