Et si la véritable force ne résidait pas seulement dans la résilience, mais dans la capacité à transformer la peur en confiance ?
Avec la psycho-agilité, Éric Chabot propose une nouvelle voie pour naviguer dans l’incertitude et réinventer son leadership. Plus qu’une méthode, c’est une posture intérieure qui permet de cultiver ses croyances, d’apprivoiser ses émotions et d’engager des actions alignées, même face à l’imprévisible.
Vous introduisez le concept inédit de “psycho-agilité”. Comment le définissez-vous concrètement ? En quoi diffère-t-il des notions de résilience ou d’intelligence émotionnelle ?
Eric Chabot : La psycho-agilité, c’est l’art de garder confiance dans sa capacité à avancer, même lorsqu’on ne sait pas encore comment s’y prendre. Là où la résilience consiste à encaisser les chocs et à rebondir après coup, la psycho-agilité est une posture proactive : elle permet de naviguer en souplesse entre confiance et peur, en ajustant ses comportements face à l’incertitude.
Pour l’illustrer, j’aime utiliser l’image d’un navigateur. La résilience, c’est quand le bateau a pris une tempête, qu’il a perdu une voile, et que l’équipage se retrousse les manches pour réparer et repartir. L’intelligence émotionnelle, c’est la capacité du capitaine à reconnaître la peur, la colère ou l’enthousiasme de son équipage, et à utiliser ces émotions pour maintenir la cohésion. La psycho-agilité, elle, va plus loin : c’est la capacité à anticiper le changement de vent, à ajuster en permanence les voiles, à garder le cap même si la météo est imprévisible.
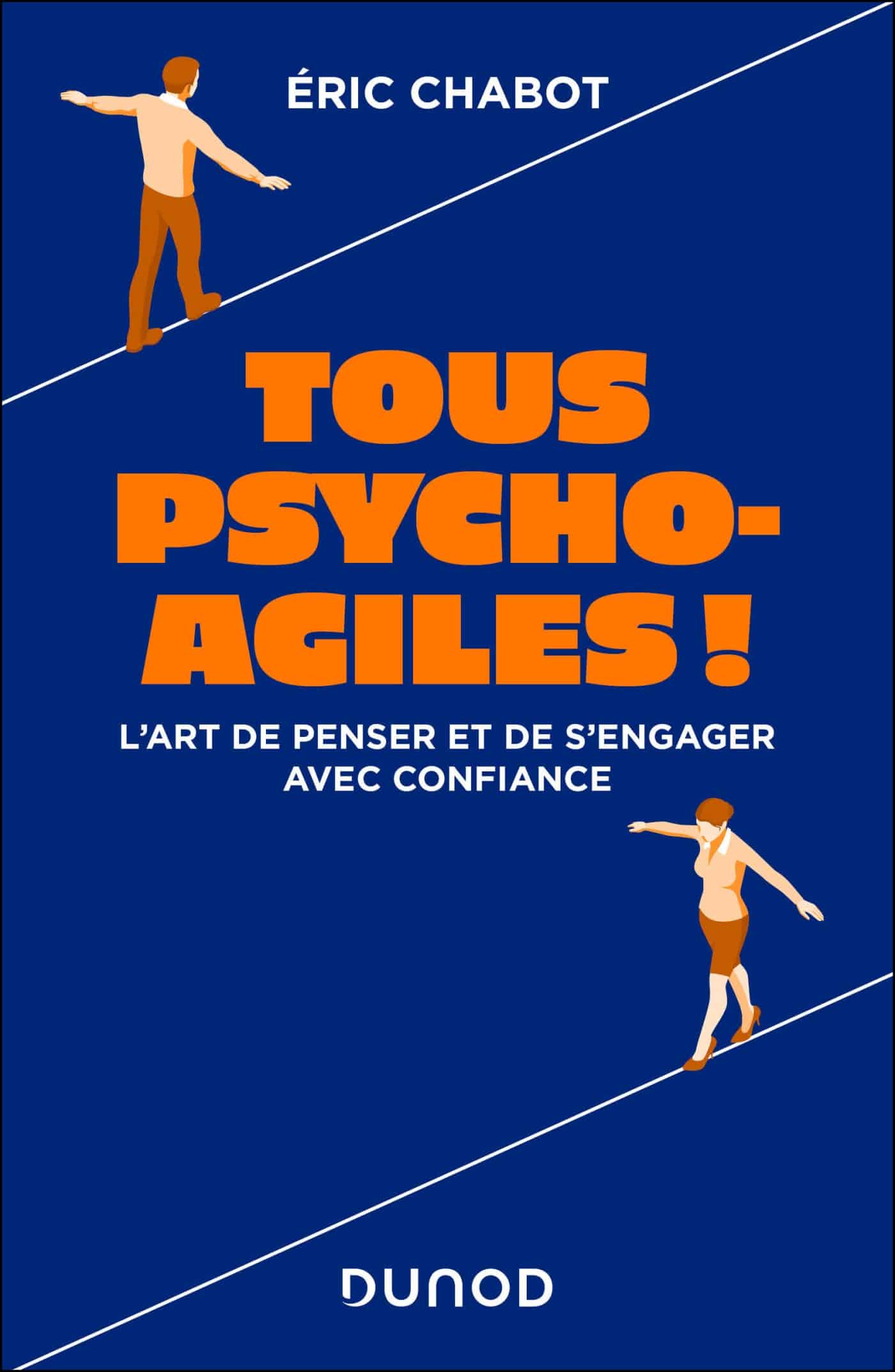
Dans Tous Psycho-Agiles ! (Éditions Dunod), je décris trois leviers qui structurent cette posture :
- L’agilité visionnaire : savoir déplacer son attention des problèmes vers les solutions, comme on apprend à retourner une pièce de monnaie pour voir l’autre face.
- La discipline émotionnelle : transformer ses émotions en énergie constructive plutôt qu’en réactions impulsives.
- La désobéissance consciente : oser remettre en cause ses croyances limitantes pour ne garder que celles qui nous tirent vers le haut.
En résumé, la résilience nous permet de survivre, l’intelligence émotionnelle de mieux nous comprendre, mais la psycho-agilité nous donne la souplesse mentale pour transformer nos peurs en confiance et engager nos actions de manière délibérée, pas conditionnée.
Votre livre évoque trois types de pensées : organiques, juteuses et racines. Pouvez-vous nous expliquer comment ces pensées interagissent et influencent notre engagement au quotidien ?
Eric Chabot : Imaginez que notre esprit fonctionne comme un arbre.
- Les pensées racines sont nos croyances profondes. Elles se situent sous la surface, invisibles, mais elles conditionnent tout : la solidité du tronc, la direction des branches et la qualité des fruits. Si les racines sont empoisonnées par des croyances limitantes, incapacitantes ou toxiques (« je ne suis pas capable », « les autres ne sont pas dignes de confiance »), alors tout l’arbre en pâtit. À l’inverse, des racines saines (« je peux apprendre », « je mérite de réussir ») nourrissent un développement harmonieux.
- Les pensées organiques, ce sont les histoires du quotidien, comparables à la sève qui circule dans l’arbre. Elles véhiculent les nutriments des racines vers les branches : « ce projet est faisable », « mon équipe me soutient », ou au contraire « je vais droit à l’échec ». La qualité de cette sève dépend directement de l’état des racines.
- Enfin, les pensées juteuses, ce sont les fruits : nos émotions. Une sève saine donnera des fruits savoureux – enthousiasme, sérénité, motivation – qui nourrissent nos comportements et notre engagement. Une sève contaminée donnera des fruits amers – colère, peur, anxiété – qui limitent notre action et empoisonnent nos relations.
En clair, les fruits visibles de nos comportements et de notre engagement ne sont que la conséquence invisible de nos racines. On ne cueille pas des pommes dorées sur un arbre aux racines malades. Si je veux transformer mes résultats, je dois commencer par travailler mes racines (mes croyances), surveiller ma sève (mes pensées du quotidien) et sélectionner les fruits qui soutiennent mon engagement.
C’est précisément l’objet de la psycho-agilité : apprendre à cultiver cet arbre intérieur pour que nos croyances, nos pensées et nos émotions travaillent ensemble au service de la confiance, de l’engagement et de la performance.
Vous parlez d’“engagement comportemental” et vous proposez un modèle alternatif à celui de B.J. Fogg. Pourquoi remplacer la motivation par la confiance, et l’aptitude par l’effort ?
Eric Chabot : Je présente d’abord le modèle de B.J. Fogg : pour qu’un comportement se produise, il faut réunir trois éléments – la motivation, l’aptitude et un déclencheur. Un exemple simple : si je ne réponds pas au téléphone, c’est soit parce que je n’en ai pas envie (motivation), soit parce que je ne peux pas matériellement (aptitude), soit parce que je n’entends pas la sonnerie (déclencheur). C’est un modèle intéressant, mais il a ses limites.
La motivation est une énergie puissante, mais ambivalente. Elle peut être élevée et pourtant agir contre mes intérêts. Un collaborateur en défiance, par exemple, sera extrêmement motivé… mais pour s’opposer, freiner ou saboter. Dans ce cas, la motivation ne garantit pas la qualité de l’engagement comportemental.
En remplaçant la motivation par la confiance, on change totalement de logique. La confiance, elle, ne présente pas cette ambiguïté : plus elle est élevée, plus elle oriente l’engagement dans une direction constructive. En augmentant la confiance, j’augmente mécaniquement la qualité de l’action qui va suivre. C’est un socle plus fiable que la motivation, qui peut être puissante mais imprévisible.
Ensuite, l’aptitude n’est pas non plus suffisante. Avoir les compétences ne garantit pas l’action. Ce qui fait la différence, c’est l’effort, c’est-à-dire la capacité à s’investir concrètement, à répéter, à persévérer. Deux enfants qui voient leur château de sable détruit peuvent réagir différemment : l’un s’effondre, l’autre recommence à construire. Tous deux avaient l’aptitude à faire, mais seul l’effort a produit un nouvel engagement.
C’est pourquoi j’ai reformulé ce modèle en Confiance + Effort + Déclencheur. La confiance sert de socle durable, l’effort transforme la compétence en action réelle, et le déclencheur permet de passer à l’acte au bon moment.
En remplaçant motivation et aptitude par ces leviers plus robustes, on passe d’un modèle conçu pour influencer les autres (comme dans la captologie et les technologies persuasives) à un modèle qui redonne le pouvoir à chacun : celui de s’engager de manière consciente, libre et psycho-agile.
Comment un manager ou une cheffe d’entreprise peut-elle cultiver la psycho-agilité dans ses équipes ?
Eric Chabot : Un manager cultive la psycho-agilité comme Toyota a instauré le cordon Andon dans ses usines. Là-bas, chaque ouvrier peut tirer un cordon pour arrêter la chaîne de production dès qu’il repère un défaut. Ce geste simple traduit une philosophie : mieux vaut stopper immédiatement et corriger ensemble que laisser passer une erreur qui coûtera plus cher plus tard.
Transposé au management, cela devient un cordon Andon psychologique : donner à chacun le droit – et même le devoir – de dire stop lorsqu’il perçoit un risque, une incohérence ou une difficulté, sans peur du jugement. C’est la meilleure manière de créer un climat de confiance où l’intelligence collective peut réellement s’exprimer.
Concrètement, cultiver la psycho-agilité repose sur trois piliers :
- Les racines : la confiance. Créer un environnement où le droit à l’erreur est reconnu, où la transparence et la reconnaissance nourrissent la sécurité psychologique.
- La sève : les pensées organiques. Orienter les conversations vers ce qui est possible, corriger les récits toxiques qui freinent l’action, comme on canalise la sève pour alimenter l’arbre.
- Les fruits : les émotions collectives. Accueillir la peur, la frustration, l’enthousiasme comme des signaux, et les transformer en leviers d’engagement plutôt qu’en freins.
Un manager psycho-agile n’impose pas l’engagement par la contrainte : il installe un cadre où chacun peut tirer son cordon Andon psychologique et contribuer à l’amélioration continue. C’est ce climat de confiance et de responsabilité partagée qui fait grandir à la fois l’équipe et la performance.
Vous évoquez la notion de “confiance asymétrique” dans la guerre cognitive. Comment un leader peut-il inspirer un engagement durable, non conditionné, dans un monde saturé d’influence ?
Eric Chabot : Nous sommes constamment sollicités pour “croire” ou “agir” dans un sens particulier : réseaux sociaux, marketing, discours politiques… C’est ce que j’appelle l’engagement asymétrique : lorsque l’on cherche à influencer vos comportements sans que vous en ayez pleinement conscience, souvent à des fins commerciales ou idéologiques.
Un leader psycho-agile doit au contraire bâtir un engagement délibéré et volontaire, seul facteur de résultat durable. Cela signifie des choses simples sur le papier mais difficile parfois à mettre en œuvre dans le quotidien :
- Dire ce que l’on fait et faire ce que l’on dit. La cohérence est le socle de la confiance durable.
- Partager ses vulnérabilités. Un leader qui reconnaît ses incertitudes crée un espace où ses collaborateurs osent aussi être vrais, plutôt que de se conformer.
- Donner des repères stables dans l’incertitude. Cela ne veut pas dire prédire l’avenir, mais clarifier les valeurs et la vision qui guident les choix collectifs.
La différence est essentielle : là où la guerre cognitive capte l’attention et manipule la peur pour obtenir un engagement conditionné, le leader psycho-agile inspire une confiance qui libère. Ce n’est pas une adhésion de surface, mais un engagement profond, aligné avec les valeurs et les convictions de chacun.
Quels sont les signaux faibles d’un désengagement psycho-agile en entreprise, et comment les repérer avant qu’ils ne deviennent problématiques ?
Eric Chabot : Le désengagement surgit rarement de manière soudaine il se manifeste d’abord par de petits signaux faibles. Le danger, c’est que ces micro-indices passent souvent inaperçus, jusqu’à ce qu’ils deviennent une crise ouverte.
On peut distinguer trois familles de signaux :
- Au niveau des pensées : les récits quotidiens deviennent défaitistes. On entend de plus en plus de phrases comme « ça ne sert à rien », « on n’y arrivera pas », « de toute façon, personne ne nous écoute », « c’était mieux avant ». Ce sont des indices que les racines de confiance s’affaiblissent.
- Au niveau des émotions : le FEET – le Foyer Émotionnel de l’Environnement de Travail – change de couleur. On remarque davantage de soupirs, de silences pesants, de frustrations non dites qui se transforment
régulièrement en « silence institutionnel ». Ces émotions refoulées sont des braises qui, si elles ne sont pas reconnues, finissent par enflammer l’ambiance collective. - Au niveau des comportements : le retrait discret remplace l’engagement visible par un engagement paresseux. Les collaborateurs ne posent plus de questions en réunion, prennent moins d’initiatives, n’osent plus tirer leur “cordon Andon psychologique”. L’absence d’opposition explicite est parfois le signe le plus inquiétant : ce n’est pas de la sérénité, mais de la résignation.
Repérer ces signaux suppose une vigilance quotidienne. Un manager psycho-agile est attentif à ce qui ne se dit pas, aux micro-comportements, aux changements subtils de dynamique dans son équipe. L’enjeu n’est pas de tout contrôler, mais de créer un climat où chacun peut exprimer ses tensions tôt, pour transformer une alerte faible en opportunité d’ajustement. Le désengagement commence par un effritement invisible de la confiance. Le repérer à temps, c’est donner à l’équipe la chance de corriger avant que la fracture ne devienne irréversible.
Vous parlez de “désobéissance consciente” comme l’une des clés. Pouvez-vous expliquer comment cela peut s’incarner dans le parcours d’une femme leader ?
Eric Chabot : La désobéissance consciente, ce n’est pas la rébellion systématique, c’est l’art d’oser remettre en cause certaines normes ou habitudes lorsqu’elles ne servent plus la mission, les valeurs ou l’efficacité. C’est choisir de désobéir non pas par provocation, mais par lucidité et responsabilité.
Pour une femme leader, ce principe prend une résonance particulière. Beaucoup ont grandi dans des environnements où on attendait d’elles qu’elles “fassent bien”, qu’elles “ne dérangent pas”, qu’elles “restent à leur place”. La désobéissance consciente consiste précisément à interroger ces injonctions implicites et à décider en conscience de ne pas s’y soumettre lorsqu’elles deviennent limitantes.
Concrètement, cela peut s’incarner de plusieurs façons :
- Refuser certains modèles de leadership stéréotypés : par exemple, croire qu’il faut “durcir le ton” pour être crédible. Une femme psycho-agile peut choisir d’incarner un style d’autorité fondé sur l’écoute et la confiance, même si cela sort des codes habituels.
- Défendre ses priorités : dire non à une surcharge de tâches “invisibles” ou “non stratégiques” qui lui sont confiées, pour concentrer son énergie là où elle a le plus d’impact.
- Proposer une nouvelle voie : oser remettre en cause des process hérités ou des manières de faire qui freinent l’innovation, en affirmant une approche différente, alignée avec sa vision.
Cette désobéissance n’est pas une rupture, c’est une réinvention. C’est ce qui permet à une femme leader de tracer son chemin sans chercher à copier des modèles existants, mais en créant un style singulier, aligné avec sa propre identité et qui inspire son entourage. La désobéissance consciente, c’est ce geste intérieur qui consiste à dire : “Je n’ai pas à entrer dans le moule. Je choisis la voie qui me permet d’être à la fois performante et pleinement moi-même.”
La psycho-agilité peut-elle aussi être un levier de reconversion ou de transformation personnelle ? Si oui, par où commencer ?
Eric Chabot : Oui, absolument. La psycho-agilité n’est pas seulement un atout professionnel, c’est aussi un moteur puissant de transformation personnelle. Dans une période de reconversion, le plus grand défi n’est pas seulement d’acquérir de nouvelles compétences, mais de trouver la posture intérieure qui permet d’avancer malgré l’incertitude.
Concrètement, cela commence par trois étapes simples :
- Travailler ses racines : questionner ses croyances profondes. Trop souvent, nous restons prisonniers de pensées comme « je ne suis pas fait pour ça » ou « il est trop tard pour changer ». La psycho-agilité invite à revisiter ces croyances pour les transformer en racines nourrissantes : « j’ai le droit d’apprendre », « je peux construire une nouvelle voie ».
- Observer ses pensées organiques : ce sont les petites histoires que l’on se raconte chaque jour. Dans une reconversion, elles peuvent être anxiogènes (« je vais échouer ») ou libératrices (« chaque étape me rapproche de mon but »). Prendre conscience de ces récits et les réorienter, c’est déjà commencer à changer sa trajectoire. Si la trajectoire est ajustée, l’impact sera différent.
- Choisir son Foyer émotionnel : toute transformation personnelle s’accompagne de peurs, de doutes ou de découragements. La psycho-agilité ne cherche pas à les supprimer, mais à les utiliser comme des signaux : la peur peut devenir vigilance, le doute peut nourrir la préparation, et l’enthousiasme peut être cultivé comme carburant.
Qu’aimeriez-vous que les lectrices de Business O Féminin retiennent comme message-clé de votre livre ?
Eric Chabot : Si je devais résumer Tous Psycho-Agiles ! en un message, ce serait celui-ci : « La confiance, c’est la capacité à s’adapter à l’incertitude. C’est la plus grande des intelligences. C’est l’intelligence de l’espoir. »
Nos pensées oscillent en permanence entre confiance et peur. Nous n’avons pas le pouvoir d’éliminer la peur, mais nous avons celui de choisir comment l’accueillir et d’apprendre à naviguer avec elle. C’est cela, la psycho-agilité : la capacité à transformer ses croyances, à apprivoiser ses émotions et à engager des actions conscientes, même dans l’incertitude.
J’aimerais que chaque lectrice retienne qu’elle n’a pas besoin de correspondre à un modèle préexistant pour réussir. Elle peut inventer sa propre manière d’avancer, en s’appuyant sur ses racines, ses récits et ses émotions, non pas comme des freins mais comme des leviers.
En un mot : vous êtes beaucoup plus libre que vous ne le pensez. La psycho-agilité est l’art de transformer cette liberté intérieure en confiance et en action.
Avez-vous un mantra ou une conviction personnelle qui guide vos engagements aujourd’hui ?
Eric Chabot : Ma conviction est simple : “La confiance est toujours le point de départ de l’engagement véritable.”
On peut obtenir l’obéissance par la peur, ou le suivi par l’intérêt, mais l’engagement volontaire – celui qui fait qu’une personne donne le meilleur d’elle-même – naît toujours de la confiance. Dans mon livre, je montre que la confiance agit comme une énergie durable, et comment développer cette énergie pour soi et pour les autres.
Et j’aimerais conclure en vous proposant cette réflexion : un leader n’est pas défini par son titre ou sa fonction, mais par sa capacité à créer un climat de confiance autour de lui. C’est cette confiance qui transforme un groupe en équipe, et une intention en engagement durable.









