De la justice à l’histoire, du plaisir au pouvoir, une nouvelle génération de penseuses et d’activistes féministes bouscule les récits dominants. À travers leurs ouvrages, leurs luttes et leurs voix singulières, elles élargissent notre regard sur ce que signifie être femme au XXIe siècle. Panorama engagé et inspirant du féminisme contemporain.
Rendre la justice aux femmes
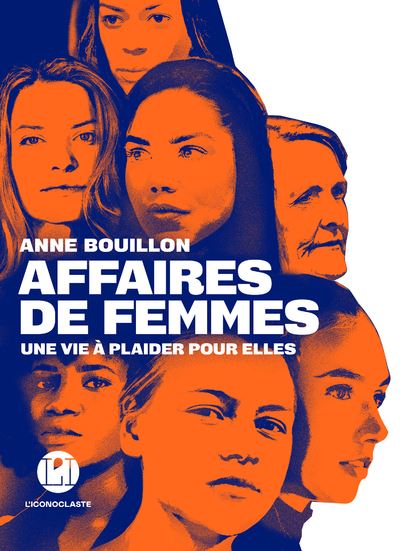
Depuis plusieurs années, la justice est au cœur des revendications féministes. Longtemps, elle a été un espace sourd aux violences subies par les femmes. C’est dans ce contexte que Anne Bouillon, avocate pénaliste engagée, fait entendre ces voix étouffées. Dans Affaires de femmes, elle ne se contente pas de relater des cas emblématiques : au contraire, elle démonte les logiques systémiques d’une justice encore profondément marquée par les biais de genre.
Ce manifeste croise expertise juridique, récit personnel et dénonciation politique, afin de promouvoir une transformation radicale du système judiciaire. En cela, elle s’inscrit pleinement dans le courant du féminisme contemporain, qui exige non seulement la reconnaissance des violences, mais aussi des institutions capables d’y répondre avec humanité et lucidité.
Réécrire l’histoire des luttes
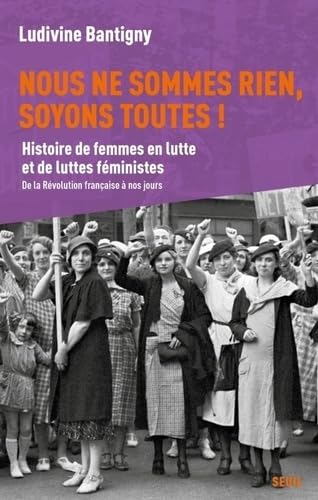
Si l’histoire officielle a longtemps marginalisé les figures féminines, Ludivine Bantigny choisit de les remettre au centre. Dans Nous ne sommes rien, soyons toutes !, l’historienne dresse une cartographie vivante et accessible des luttes féministes, de l’Ancien Régime à nos jours. Par ailleurs, son approche est à la fois rigoureuse et militante : elle exhume des trajectoires oubliées, des collectifs méconnus, des élans populaires invisibilisés.
En redonnant toute sa place à cette mémoire collective, elle participe à une entreprise majeure du féminisme contemporain : reconnecter les combats d’aujourd’hui à ceux d’hier, et ancrer les revendications actuelles dans une longue histoire de résistance.
Sororité : promesse ou illusion ?
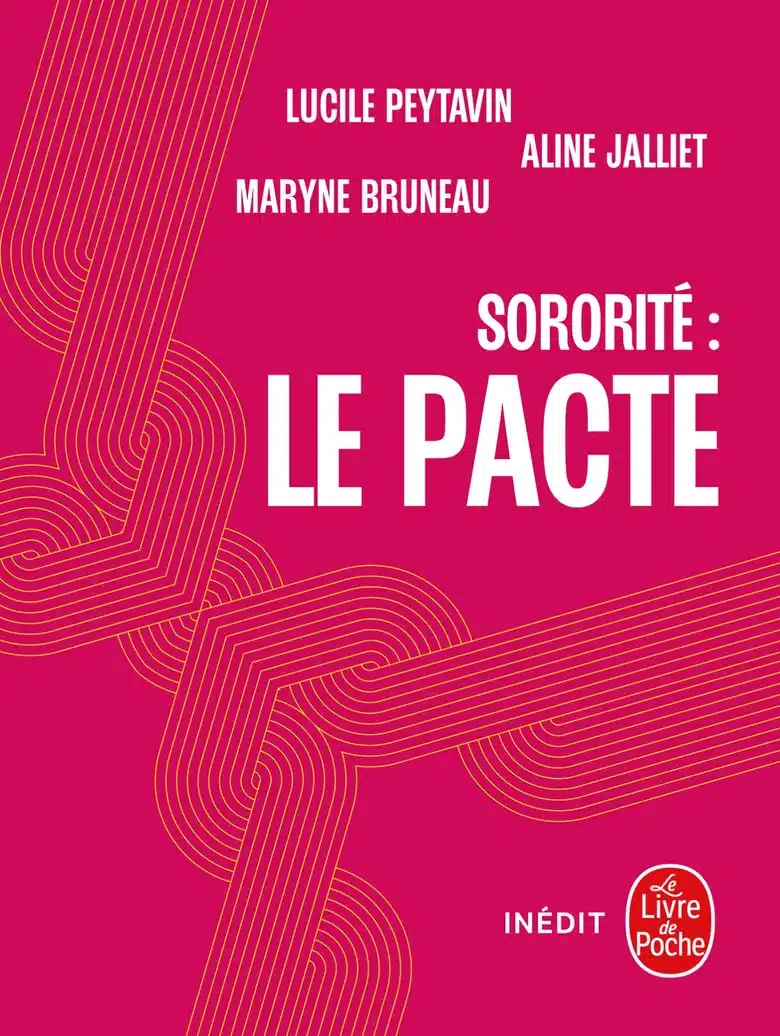
Aujourd’hui plus que jamais, le mot sororité résonne dans les mobilisations féministes. Cependant, ce concept mobilisateur mérite d’être interrogé. Dans Sororité : le pacte, Lucile Peytavin, Aline Jalliet et Maryne Bruneau analysent les tensions internes au féminisme : entre femmes de milieux différents, entre blanches et racisées, entre générations aussi. Ainsi, loin des injonctions à une unité illusoire, ce trio d’autrices ouvre un débat nécessaire sur la possibilité d’un pacte solidaire réellement inclusif.
Leur essai s’inscrit dans une démarche constructive : penser les fractures, sans renoncer aux alliances. Une démarche profondément fidèle aux exigences critiques du féminisme contemporain, qui refuse les simplifications.
Une mémoire vivante du féminisme
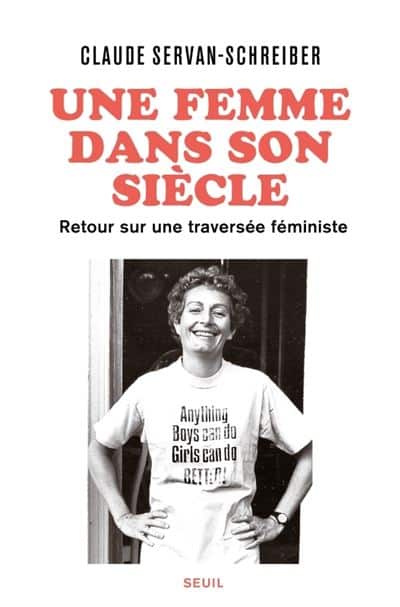
À travers son parcours, Claude Servan-Schreiber donne chair aux combats féministes. Journaliste, éditorialiste, observatrice privilégiée des évolutions sociales, elle revient dans Une femme dans son siècle sur cinq décennies d’engagements. Avec une écriture sensible et engagée, elle mêle souvenirs intimes et observations politiques. Autrement dit, son regard, nourri de rencontres et d’analyses, montre combien les acquis restent fragiles : droit à l’avortement, parité, liberté sexuelle… En retraçant ces avancées et leurs menaces actuelles, elle nous rappelle que rien n’est jamais acquis.
De ce fait, son ouvrage agit comme une archive incarnée du féminisme contemporain, nourrie de chair, d’émotions et de convictions.
Masculinité en mutation : un dialogue nécessaire
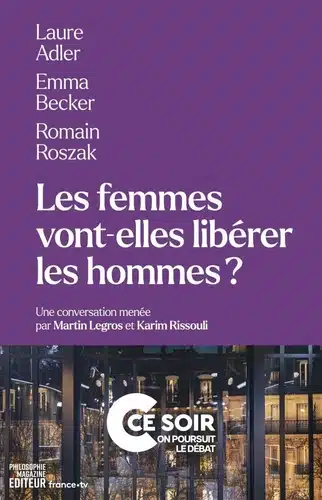
Dans une société en transformation, les masculinités sont aussi en question. Les femmes vont-elles libérer les hommes ? : la question posée par Laure Adler, Emma Becker et Romain Roszak ne manque pas de provocation. Mais au-delà de la formule, se cache une réflexion subtile sur la crise des masculinités. Les rôles de genre s’effritent, les attentes évoluent, les repères traditionnels vacillent. À ce titre, cet ouvrage interroge la manière dont les hommes peuvent – et doivent – participer à la déconstruction du patriarcat.
Une approche dialogique et inclusive qui rejoint l’ambition du féminisme contemporain : ne plus penser l’émancipation des femmes contre les hommes, mais avec eux, dans un projet commun de libération.
Plaisir féminin : une révolution intime
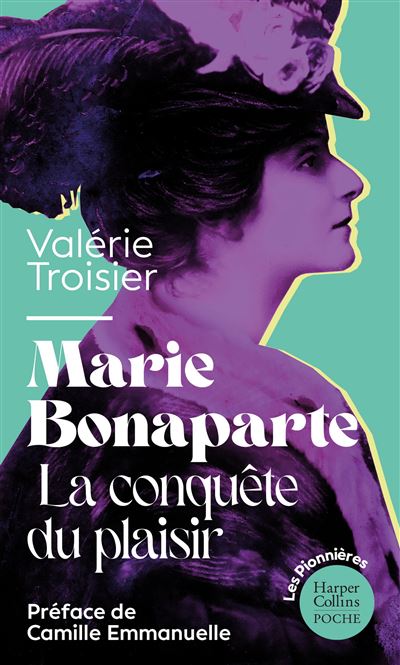
Longtemps ignoré, le plaisir féminin a été relégué aux marges du discours médical et social. Pourtant, Marie Bonaparte, princesse et psychanalyste, a mené un combat discret mais essentiel. Dans Marie Bonaparte : la conquête du plaisir, Valérie Troisier lui rend justice. Elle décrit une femme en avance sur son temps, qui brava les tabous médicaux, sociaux et psychanalytiques pour défendre l’idée que le corps féminin méritait l’attention, la compréhension et la liberté.
Ce portrait résonne avec les combats actuels pour une éducation sexuelle féministe et inclusive, et s’inscrit dans la grande fresque du féminisme contemporain.
Donner de la voix à celles qu’on a fait taire
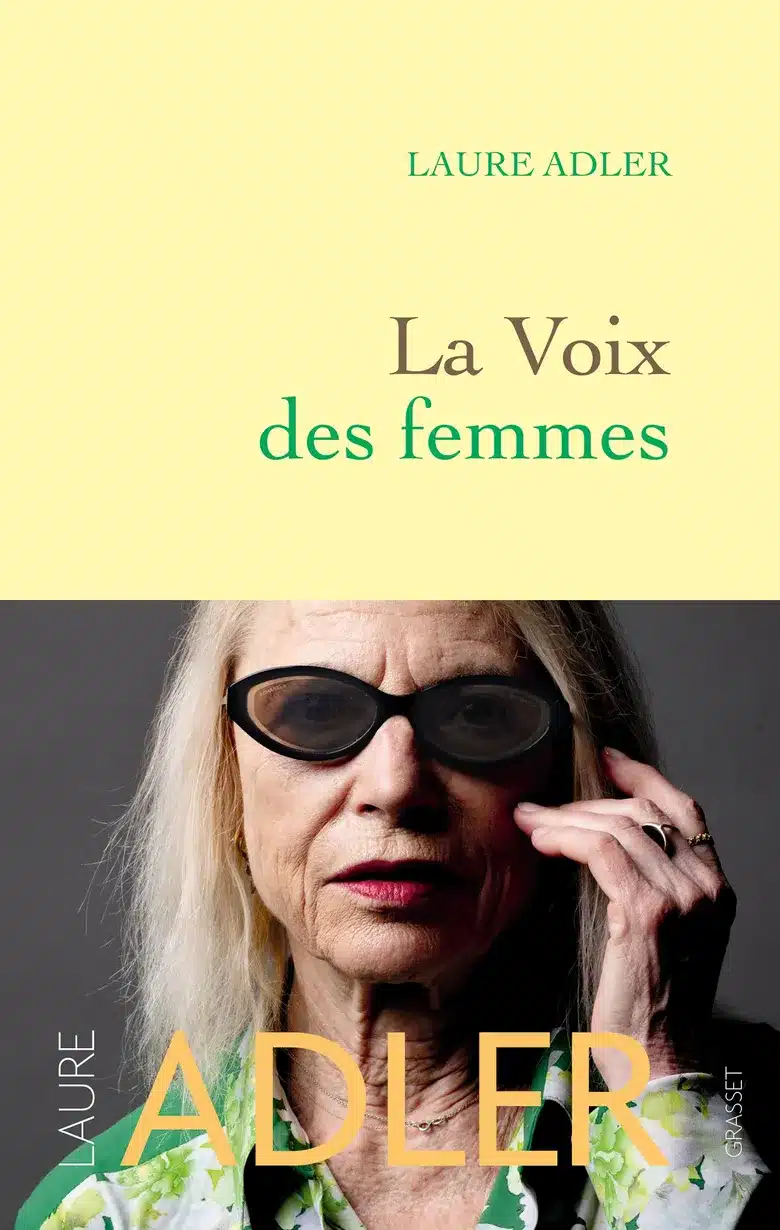
Au fil des siècles, les femmes ont été réduites au silence. C’est précisément contre cette amnésie que Laure Adler s’élève dans La voix des femmes. Autrice, éditrice, historienne des idées, elle explore les silences imposés aux femmes à travers l’histoire. Elle montre combien la parole féminine peut être puissante, transgressive, transformante. Ainsi, c’est en redonnant cette voix, en valorisant sa richesse, ses colères et ses nuances, que l’on bâtit une société plus juste.
Ce plaidoyer s’inscrit dans la continuité des grands textes du féminisme contemporain, qui font de la prise de parole un acte de reconquête.
Se libérer de la culpabilité intériorisée
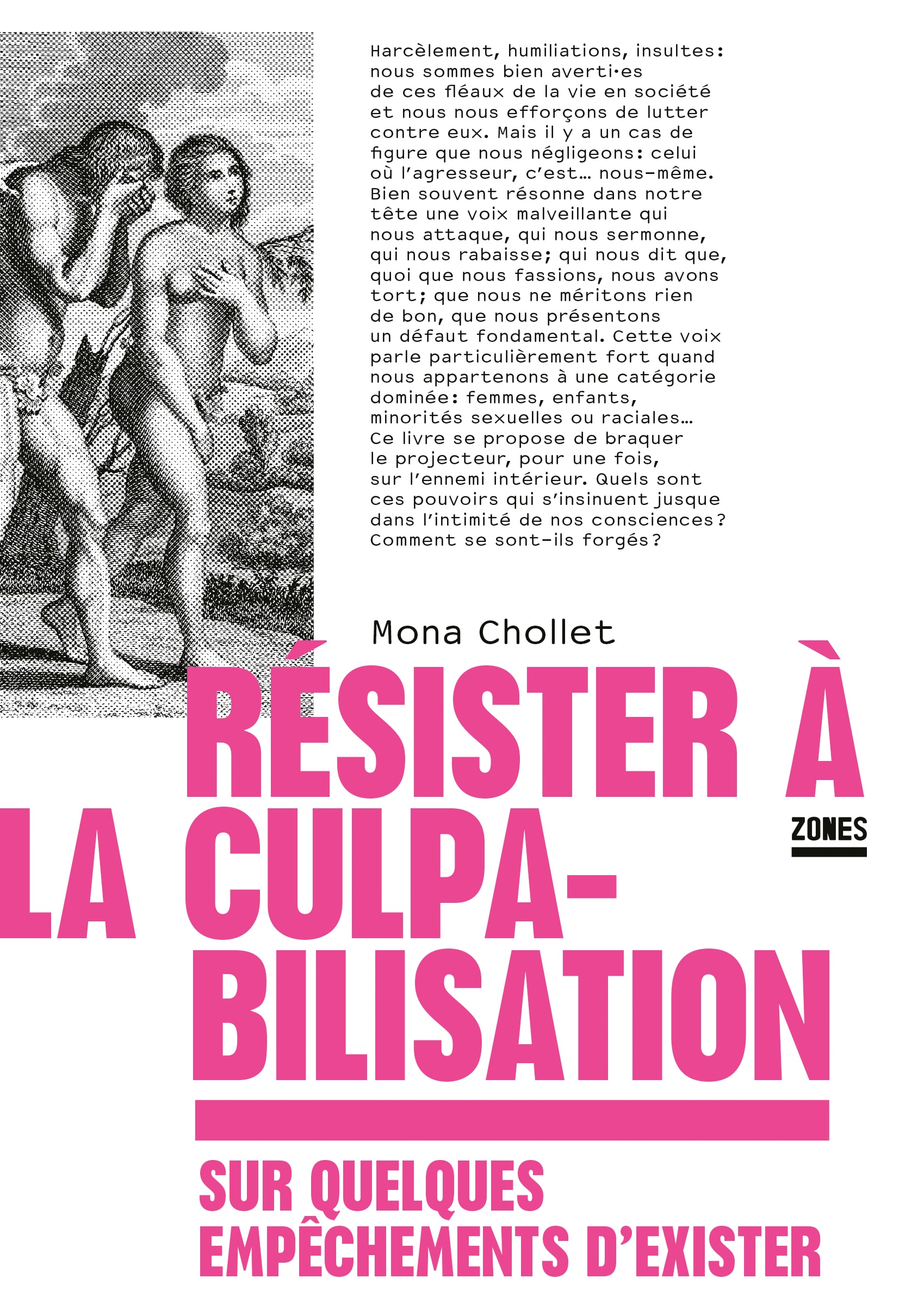
Mona Chollet clôt ce panorama avec un angle essentiel : celui de la déconstruction intérieure. Connue pour ses essais percutants, elle poursuit son exploration des injonctions pesant sur les femmes dans Résister à la culpabilisation. D’une part, elle démonte les mécanismes insidieux qui poussent les femmes à s’excuser d’être ambitieuses, indépendantes, ou simplement elles-mêmes. D’autre part, elle propose une analyse structurée de cette culpabilité intériorisée, et en appelle à une réappropriation de soi, libre et assumée.
Son travail s’inscrit pleinement dans les chantiers ouverts par le féminisme contemporain : démanteler l’invisible, pour mieux reconstruire.









