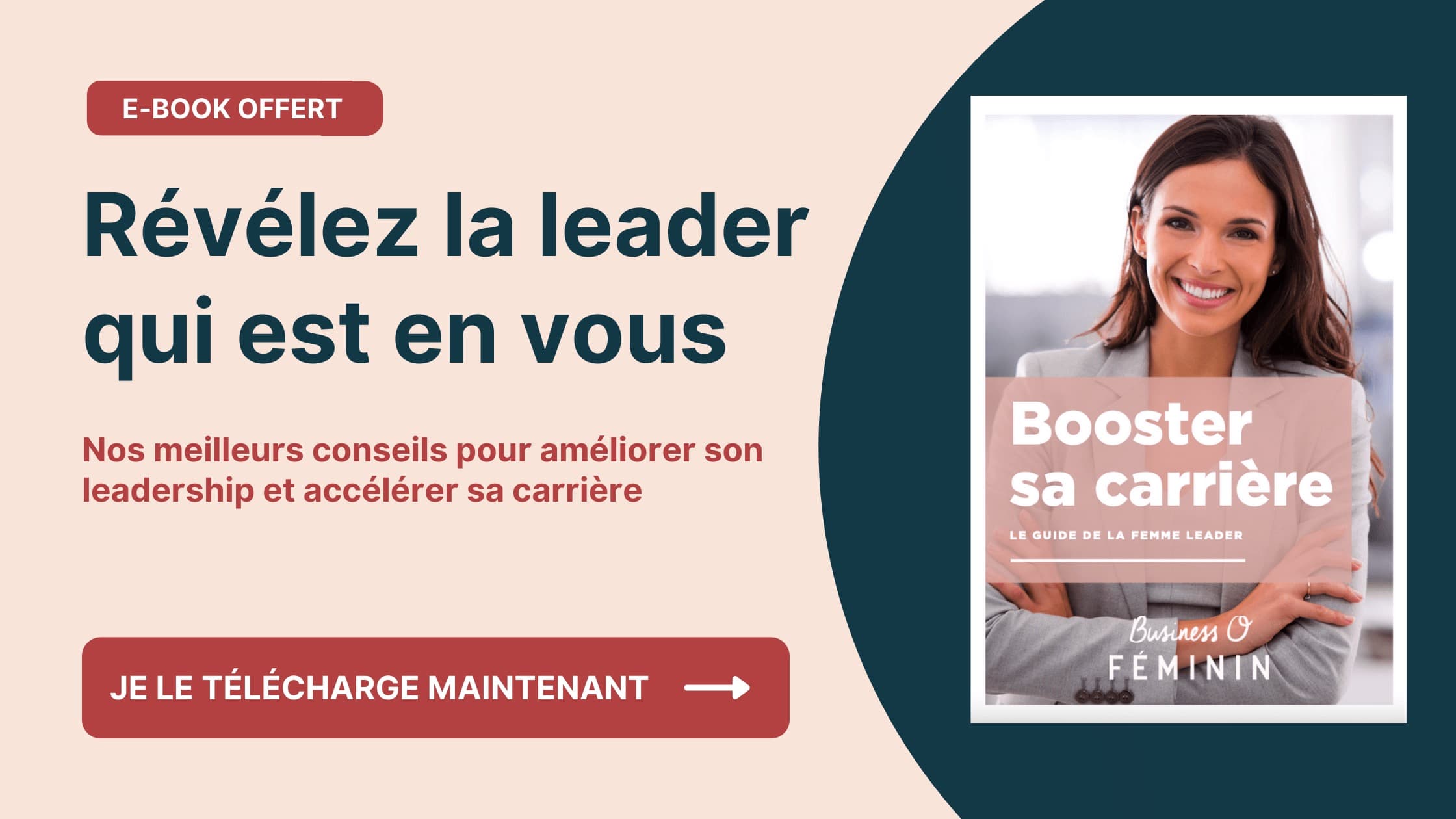Après 10 ans d’allers-retours, la directive Women On Boards a été approuvée par le Conseil le 17 octobre 2022. Depuis le 28 décembre 2024, elle doit être transposée en droit des Etats membres. Qu’en est-il ?
Un peu d’histoire
Il y a plus de 10 ans, Viviane Reding, vice-présidente de la Commission européenne avait lancé un appel aux sociétés cotées d’Europe les invitant à « accroître volontairement la présence des femmes dans leurs conseils » qui n’avait trouvé écho qu’auprès de 24 sociétés européennes. Le 14 novembre 2012, la Commission européenne avait adopté un premier projet de proposition de directive, partant du constat qu’entre 2003 et 2012, la représentation des femmes au sein des conseils d’administration des sociétés n’avait progressé que de 0,6 % en moyenne en Europe et par an. Le texte visait à « briser le plafond de verre » des instances dirigeantes des entreprises européennes.
Plusieurs pays s’y étaient opposés estimant que cette matière relevait du droit interne des États-membres, voire des codes de gouvernance : en septembre 2012, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Bulgarie la Lettonie, l’Estonie, la République tchèque, la Lituanie, la Hongrie et Malte avaient adressé une lettre à la Commission pour exprimer leur désaccord. L’Allemagne, non cosignataire, était également défavorable à une législation européenne (bien que la ministre du travail alors en poste Ursula von der Leyen soutienne le projet). La Commission après une bataille que VR qualifie de la « plus rude de sa carrière » renonçait.
10 ans après une progression lente et disparate
Cependant, dix ans après, un constat sans équivoque de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes est fait : les femmes ne représentent en moyenne que 33,8% des membres des conseils d’administration dans l’Union européenne en 2023, sachant que derrière cette moyenne se cache une réalité très disparate car certains pays ont imposé des quotas.
Parmi eux la moyenne se situe à 39,6% des membres des instances dirigeantes contre 17% dans les pays qui n’ont pris aucune mesure de discrimination positive équivalente.
D’après un rapport du Parlement Européen, de 2021, 9 pays ont introduit un système de quotas : France, Italie, Allemagne, Portugal, Espagne, Belgique, Pays-Bas, Autriche et Grèce. Ces pays ont naturellement un pourcentage de femmes dans les conseils d’administration plus élevé, avec un podium composé de la France (46,1%), de l’Italie (43%) et du Danemark (41,4%). À l’inverse, les pays sans législation les plus inégalitaires sont Chypre (8,2%), la Hongrie (10,5%) et l’Estonie (12%).
Ces statistiques globales ne permettent pas de rendre compte de la situation exacte sur le terrain, car la formulation des quotas, leur périmètre d’application, etc. est variable.
La directive Women On Boards
Le 22 novembre 2022, est adoptée la directive européenne 2022/2381 – directive Women On Boards, sous présidence française.
Elle impose que les organes d’administration des sociétés cotées – de plus de 250 salariés et présentant un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros ou un total de bilan de 43 millions d’euros – soient composés d’une part minimale du sexe sous-représenté (la plupart du temps, le sexe féminin). Les entreprises devront respecter au moins un de ces deux critères : les membres du sexe sous-représenté occupent soit au moins 40% des postes d’administrateurs non exécutifs soit au moins 33% des postes d’administrateurs (exécutifs ou non-exécutifs).
Les Etats avaient jusqu’au 28 décembre 2024 pour transposer cette directive, tandis que les sociétés concernées auront jusqu’au 30 juin 2026 pour atteindre ces objectifs. La directive entend également s’assurer que les États membres imposent des sanctions dissuasives, pouvant aller jusqu’à l’annulation des nominations au conseil d’administration, en cas de non-respect de non-respect des critères énoncés.
Les quotas sur les CA et CAS (loi Copé-Zimmermann 2011) et des actualisations en 2024
L’ordonnance du 15 octobre 2024 crée des mesures complétant la loi Copé-Zimmermann de 2011. Cette loi disposait que les conseils d’administration et de surveillance de sociétés, cotées ou non, de plus de 250 salariés et présentant un montant net de chiffre d’affaires ou un total de bilan d’au moins 50 millions d’euros devaient comporter une proportion minimale de 40% pour le sexe le moins représenté.
L’ordonnance vient renforcer la loi, sur plusieurs aspects :
- L’article 1 de l’ordonnance étend les règles de respect de parité aux administrateurs représentants des salariés ainsi qu’aux salariés actionnaires, qui étaient auparavant exclus de l’assiette de calcul.
- Les articles 11, 18 et 20 prévoient qu’une entreprise visée par la directive devra recourir à une procédure de sélection spécifique pour nommer des membres de son conseil d’administration ou de son conseil de surveillance dès lors que les exigences de parité ne seront pas respectées.
- Les articles 13 et 16 prévoient que les sociétés concernées par la directive devront publier sur leur site internet et informer une autorité désignée des informations relatives au respect de l’obligation d’équilibre entre les femmes et les hommes prévue par la directive européenne.
Les entreprises concernées seront également tenues de désigner un ou plusieurs organismes chargés de promouvoir, d’analyser, de surveiller et de soutenir l’équilibre entre les femmes et les hommes dans les conseils. L’ordonnance élargit aussi l’application des règles de parité aux sociétés dont l’Etat détient des participations, en vue de s’assurer que ce dernier, même par le biais de sociétés dont il a un contrôle partiel, respecte bien l’obligation de parité.
Des quotas dans les espaces exécutifs avec la loi Rixain
En décembre 2021, la France fait de nouveau un pas pour favoriser l’accélération de l’intégration économique des femmes, en adoptant la Loi Rixain, qui élargit les obligations paritaires concernant les conseils d’administration aux comités exécutifs et comités de direction.
La loi instaure ainsi une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les postes de direction des grandes entreprises, accompagnée d’une obligation de transparence. Plus précisément, les entreprises qui emploient plus de 1000 salariés depuis trois trimestres consécutifs doivent à présent calculer et publier leurs écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes parmi leurs cadres dirigeants et les membres de leurs instances dirigeantes.
D’ici le 1er mars 2026, ces mêmes entreprises devront avoir dans leurs structures 30 % de femmes et d’hommes cadres dirigeants et de 30 % de femmes et d’hommes membres d’instances dirigeantes. Ce chiffre de 30% passera à 40% en 2029.
Alors que la transposition de la directive Women On Board est censée être finalisée, et sachant que neuf pays – en plus de la France – avaient déjà légiféré avant la directive : l’Espagne, la Belgique, l’Italie, les Pays-Bas, l’Allemagne, l’Autriche, le Portugal et la Grèce.
Focus sur quelques textes nationaux
Le 31 janvier 2025, la Commission a appelé les États membres n’ayant pas communiqué les mesures de transposition prises : Belgique, Tchéquie, Estonie, Grèce, Chypre, Lettonie, Luxembourg, Hongrie, Pays-Bas, Autriche et Roumanie.
La Bulgarie s’est quant à elle fait rappeler à l’ordre pour ne pas avoir intégralement transposé la directive. Les États concernés disposent de deux mois pour répondre, finaliser leur transposition et notifier leurs mesures à la Commission. En l’absence de réponse satisfaisante, la Commission pourra décider d’émettre un avis motivé.
Viviane de Beaufort